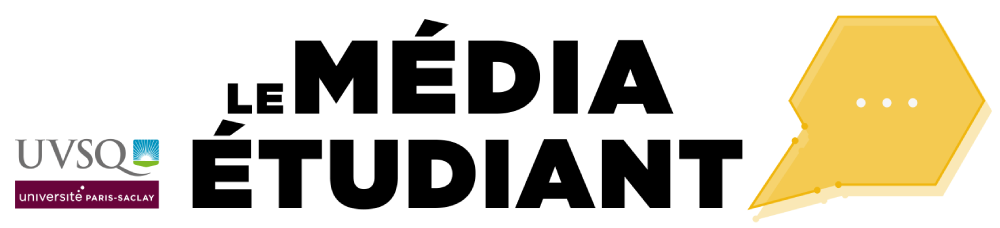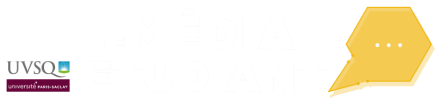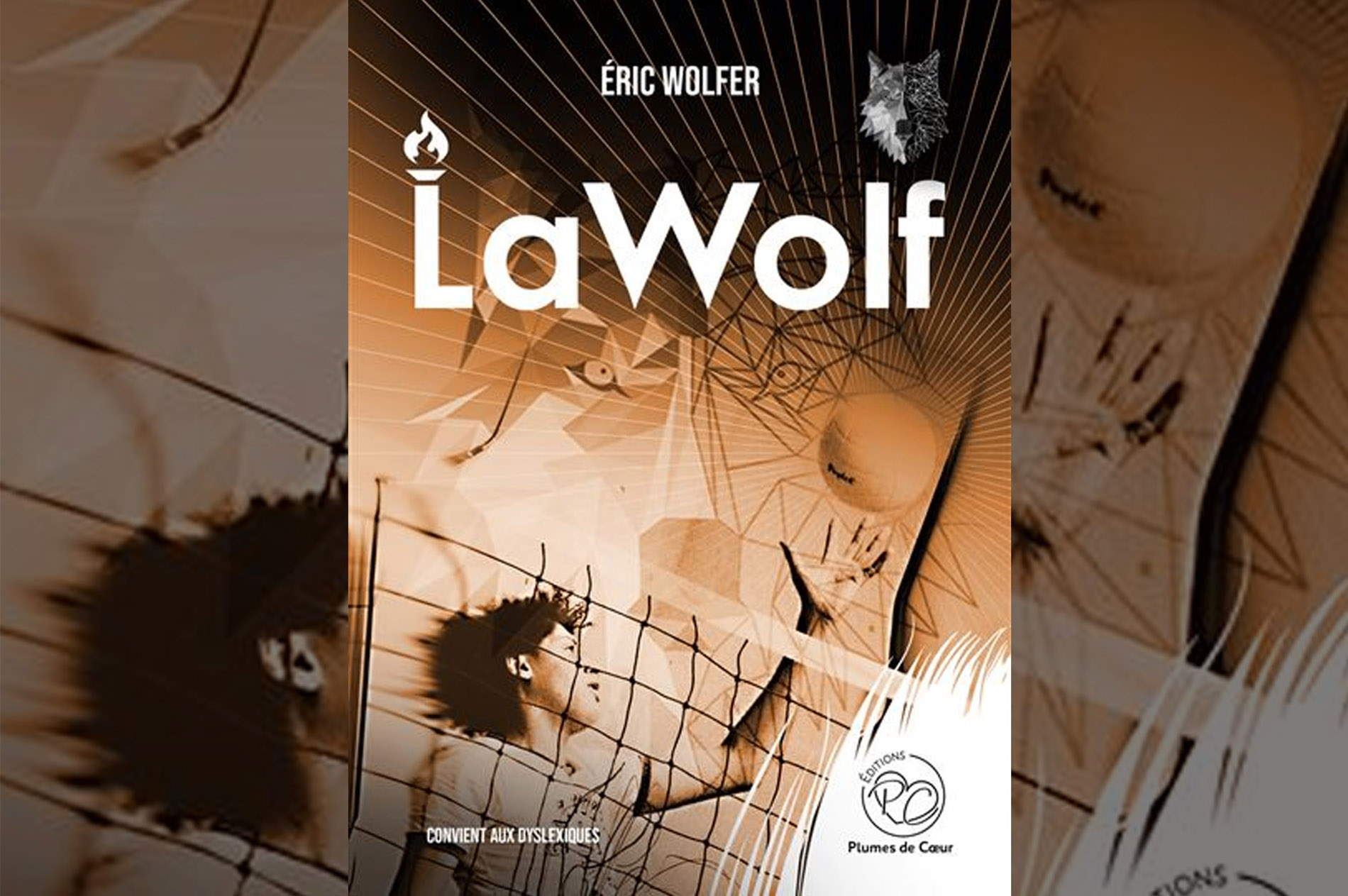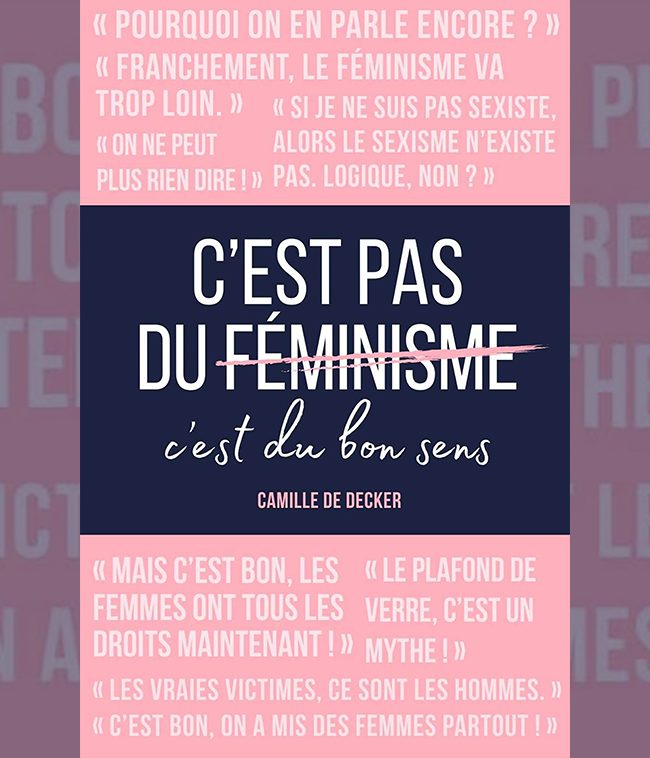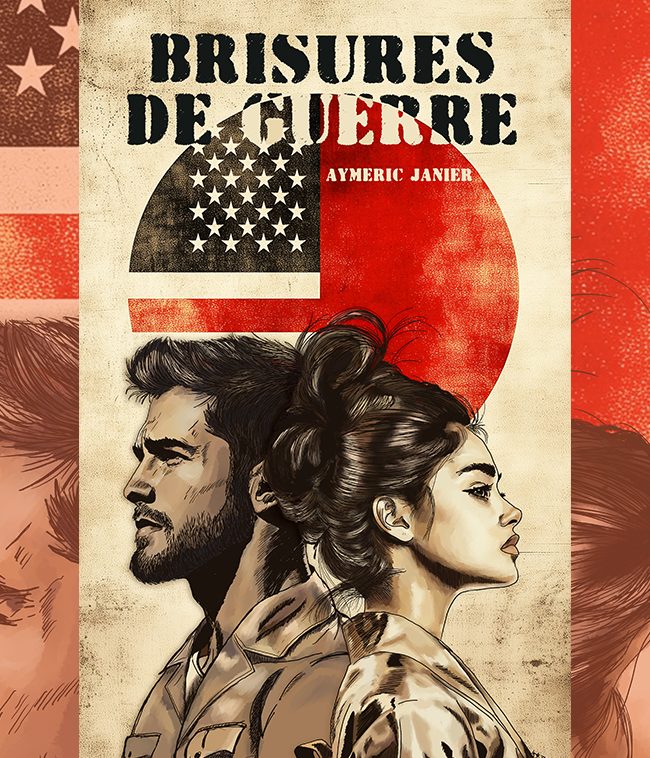Il y a, dans certains récits autobiographiques contemporains, une urgence qui dépasse la seule ambition littéraire. La Wolf, autobiographie d’Éric Wolfer coécrite avec Mélodie Ducoeur, s’inscrit dans cette tradition des écritures du réel où l’intime devient politique, et où le parcours individuel éclaire les impasses collectives.
Loin des modèles classiques de l’ascension héroïque, Wolfer propose un témoignage sans fard sur une enfance et une adolescence cabossées, marquées par la déscolarisation, la violence familiale et la stigmatisation sociale. Placé à quinze ans en centre éducatif fermé, il raconte non seulement l’expérience carcérale des dispositifs de protection de l’enfance, mais aussi, et surtout, l’apprentissage d’une survie psychique par le biais du sport.
La Wolf, une récit humain
Le récit, d’une grande oralité assumée, privilégie la restitution brute des émotions et des souvenirs. Il traduit la dislocation progressive d’un adolescent pris entre un système éducatif inadapté, une cellule familiale dysfonctionnelle, et des mécanismes institutionnels d’exclusion. Le choix de la première personne, renforcé par la narration simple mais tendue, permet d’éviter toute idéalisation rétrospective : Éric Wolfer ne s’érige jamais en victime ni en modèle. Il livre une trajectoire complexe, faite d’élans et de chutes, de fragilités persistantes et d’instants de grâce.
Le sport apparaît alors non seulement comme une soupape corporelle, mais comme un espace de reconfiguration identitaire. Le terrain de Volley (sport dans lequel il fera carrière), le ring de boxe, les parquets de handball deviennent autant de lieux de réinvention sociale, où le jeune marginalisé trouve reconnaissance, dépassement et appartenance. Cette expérience n’est pas sans rappeler certains travaux sociologiques sur la fonction réparatrice du sport dans les processus de réinsertion des jeunes en difficulté.
Une écriture fluide et touchante
L’écriture de Mélodie Ducoeur, discrète mais efficace, propose une mise en forme sans trahir la voix originelle. Elle donne au récit une cohérence rythmique tout en conservant son énergie première. On ressent une véritable éthique de l’écoute dans cette collaboration : l’auteur principal reste maître de son histoire, dans ses éclats comme dans ses silences.
En définitive, La Wolf s’impose comme un document littéraire et sociologique précieux. À travers le parcours singulier d’Éric Wolfer, c’est tout un pan souvent invisible de la jeunesse populaire française qui se raconte : ses blessures, ses ressources, ses stratégies de survie. Un ouvrage qui, sans jamais tomber dans le misérabilisme, invite à repenser la place du sport, de l’éducation, et du soutien psychologique dans les trajectoires de jeunes confrontés à la marginalité. Un livre à recommander autant aux étudiants en sciences humaines qu’aux passionnés de littérature du réel.